de l’Alkahest ou Elixir de longue vie
» en alchimie, tout dissolvant, ou menstrue, portant aussi le nom de clef, il apparait que le vitriol des sages, qui est en somme un alcali, était et demeure le véritable Alkaest » Eugène Canseliet in Mutus Liber
De Paracelse à Pierre Jean Fabre
L’alkalhest (Alchahest chez Paracelse, et d’autres orthographes sont utilisées suivant les auteurs) est une hypothétique substance alchimique. Le mot, inventé par Paracelse pour désigner une mystérieuse médecine pour le foie, fut repris par Jean-Baptiste van Helmont qui en fait le dissolvant universel capable de ramener tout corps à sa matière première (la materia prima des alchimistes). Malgré des propriétés paradoxales, dissolvant toute matière il ne peut être contenu dans aucun récipient, le concept connaîtra une fortune importante chez les chimistes alchimistes de la seconde moitié du XVIIe jusqu’au début du XVIIIe siècle.
Le terme Alchahest apparaît une seule fois dans l’œuvre de Paracelse, qui ne s’intéressait qu’à l’aspect médicinal des produits alchimiques, et ne croyait pas à la transmutation des métaux. Il se trouve dans un petit traité inachevé, le De viribus membrorum (1526-1527), qui présente les médicaments pour les différents organes du corps humain :
« Il y a encore la liqueur Alchahest, qui possède grandes force et efficacité pour conserver et renforcer le foie, ainsi que pour préserver de l’hydropisie sous toutes ses formes qui proviennent des vices du foie. On l’obtient ainsi : il se dissout à partir de la coagulation, et il se coagule à nouveau en forme transmutée, comme le montre le processus de coagulation et de dissolution. Alors en effet s’il l’emporte sur son semblable, c’est un remède pour le foie supérieur à tous les remèdes. Et même si le foie est déjà démoli et détruit, il tient lui-même le rôle du foie, pas autrement que si celui-ci n’avait jamais été démoli et détruit. Il s’ensuit que quiconque fera œuvre de médecine devra travailler avec le plus grand soin à apprendre la préparation de l’Alchahest, parce qu’il éloigne les nombreuses maladies qui proviennent du foie. »
Paracelse, pour marquer sa volonté de rupture avec les médecines traditionnelles galiénique et aristotélicienne, forgea de nombreux néologismes. Lorsque ses idées et ses ouvrages se répandirent dans la seconde moitié du XVIIe siècle (le « renouveau paracelsien »), ses disciples composèrent des lexiques. Le premier à définir l’alkahest est Michael Toxites en 1574, qui le définit comme « du mercure préparé pour le foie », en le rapprochant d’un mysterium mercurii lui aussi présenté par Paracelse comme un médicament pour le foie. Cette définition fut reprise en 1578 par le paracelsien français Roch le Baillif, et en 1583 par le belge Gérard Dorn, et se retrouva finalement dans le dictionnaire mis en annexe de l’édition latine des œuvres de Paracelse, Paracelsi opera omnia (1658).
De son côté Martin Ruland (1532-1602), médecin de l’empereur Rodolphe II, propose deux définitions en jouant sur les orthographes Alcahest et Alchahest, le premier étant le mercure préparé, et le second la médecine pour le foie.
Jean-Baptiste Van Helmont reprend la notion de Paracelse mais lui donne un sens plus précis. Il sert à réduire tous les corps en leur matière première :

Qu’est-ce que l’Alkaest ?
C’est un Menstrue, ou Dissolvant universel qu’on peut appeler d’un seul mot eau de feu : c’est un être simple et immortel, qui pénètre toutes choses et les résout en leur première matière liquide : rien ne peut résister à sa vertu ; il agit sans réaction de la chose sur laquelle il agit, et ne souffre que son semblable, qui seul le met sous le joug. Après qu’il a dissous toute autre chose, il demeure tout entier à sa première nature, et n’a pas moins de vertu après avoir servi mille fois, qu’il en avait en sa première action.
Quelle est sa substance ?
Sa substance est un excellent Sel circulé, préparé d’une manière admirable jusqu’à ce qu’il réponde aux désirs d’un subtil Artiste. Car il ne faut pas s’imaginer que ce soit un Sel corporel, tel que, rendu liquide par une simple dissolution : mais bien un esprit salin que la chaleur ne saurait épaissir par l’évaporation de son humidité : la substance étant spirituelle, uniforme, volatile à une petite chaleur, et ne laissant rien après son évaporation. Ce n’est point un esprit acide ni alcalisé, mais un esprit salin. »
« Le premier agent magnétique servant à préparer le dissolvant, – que certains ont dénommé Alkaest, – est appelé Lion vert, non pas tant parce qu’il possède une coloration verte, que parce qu’il n’a point acquis les caractères minéraux qui distinguent chimiquement l’état adulte de l’état naissant…
Quant au Lion rouge, ce n’est autre chose, selon les Philosophes, que la même matière, ou Lion vert, amenée par certains procédés à cette qualité spéciale qui caractérise l’or hermétique ou Lion rouge... » Fulcanelli in Le Mystère des cathédrales
LEIBNIZ
Le grand Leibniz affirme en 1671 que « possibilis est Liquor Alcahest ». On sait qu’il fut employé par une société d’alchimistes à Nuremberg pendant l’hiver 1666-1667, qu’il connaissait fort bien les textes alchimiques, qu’il ne cessa d’être en contact avec de multiples personnages qui cherchaient à opérer la transmutation des métaux et qu’il semble même avoir encouragé leurs recherches par une participation financière, bien qu’il doutât de la possibilité de l’opération et qu’il ait développé quelques objections théoriques contre la doctrine. C’est dans les années soixante-dix qu’il semble s’intéresser à l’alkahest. En particulier, dans ses Hypothesis physica nova de 1671, après avoir affirmé que l’Archeus de Van Helmont et le Rector de Tachenius n’étaient rien d’autre qu’un aether universalis ou spiritus mundi, il ajoute que ce sel céleste possède toutes les vertus que Van Helmont reconnaît à son alcahest, qui veut dire « alcali est ».
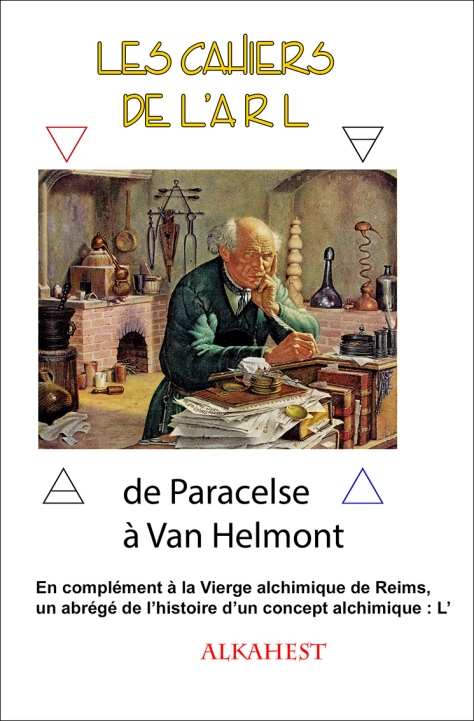
Quant au célèbre chimiste hollandais Hermann Boerhaave, il consacre au sujet une vingtaine de pages dans les Elementa chemiae de 1732. Tout en reconnaissant qu’il est « impossible d’indiquer un seul moyen physique pour opérer ainsi une solution universelle », il affirme que l’alkahest, s’il existe, doit être regardé « comme le don le plus précieux que Dieu ait accordé aux hommes par le moyen de la chymie », reprenant ainsi, sans le nommer, les propos de Glauber en 1651 dans son Operis mineralis. Puis il rapporte le jugement de Boyle évoqué plus haut, en précisant que les efforts de ce dernier pour découvrir ce secret étaient restés vains. Il expose alors longuement toutes les propriétés de l’alkahest, à travers de nombreuses citations de Van Helmont, puis il prend position contre ceux qui veulent le fabriquer à partir de l’urine, du phosphore ou du nitre, pour considérer enfin que c’est dans les écrits de Pierre-Jean Fabre et de Becher que l’on trouve les remarques les plus intéressantes sur le sujet. Mais il conclut ainsi : « Je ne sais pas trop bien ce que je dois penser là-dessus. »
Pour tous ceux qui s’intéressaient à la « chymie » dans la seconde moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, l’alkahest constitua l’un des enjeux principaux de la théorie et un objet privilégié des travaux de laboratoire. La recherche d’un dissolvant universel s’inscrivait dans les préoccupations chimiques d’une époque soucieuse de donner à l’analyse chimique de nouveaux moyens d’investigation. Cependant, une telle quête ne pouvait avoir du sens que parce qu’elle s’inscrivait dans le cadre ancien de la théorie alchimique et de la réduction de tous les corps en leur matière première. Cette référence alchimique souvent implicite permettait de penser sans contradiction un produit chimique dont le concept même nous paraît absurde. C’est Van Helmont qui créa les conditions de possibilité d’une telle situation, en identifiant la médecine pour le foie de Paracelse avec le dissolvant universel de l’alchimie traditionnelle. C’est donc le cheminement qui conduisit du texte paracelsien à la doctrine helmontienne dont l’article de l’Encyclopédie recueille tardivement la tradition qu’il nous faut maintenant retracer.






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.