L’étude des trois grandes traditions monothéistes montre qu’elles ne peuvent être conçues sans une angélologie. Il faut rendre au concept d’ange toute sa densité : l’ange n’est pas simplement le messager, selon l’acception courante, il est fondamentalement la condensation d’une énergie divine, une intelligence céleste et le prototype d’une réalité créée. Aussi le monde angélique apparaît comme le fondement de l’ordre universel, qu’il régit et maintient dans la durée, et comme ce qui assure la liaison spirituelle entre tous les degrés de la réalité.
Comment, dans ces conditions, une figure aussi essentielle a-t-elle pu disparaître à ce point dans le christianisme occidental? Est-il vrai que l’Incarnation christique rende obsolète l’être céleste, et que rejette-t-on exactement en évacuant celui-ci? Une enquête sur le devenir historique de l’angélologie et de la présence de l’ange en Occident apporte des éléments de réponse, de même que leur confrontation avec l’Orient orthodoxe et avec les doctrines islamiques. Elles permettent de mieux évaluer les différences de perspectives et les divergences de destin. En particulier, la sécularisation de l’époque moderne n’est-elle pas liée, pour une part, à cette disparition de la figure angélique ? Car, au fond, l’ange est infiniment plus qu’un objet de croyance devenu suranné: il est objet de connaissance, vecteur d’une révélation, et voie d’accès à une connaissance supérieure, en mouvement ascensionnel vers le mystère divin. Faute de savoir goûter cette nourriture céleste, l’homme occidental se rapetisse et se perd parmi les biens de la terre.
En vérité, les enjeux de l’angélologie sont considérables. L’homme, l’univers, la Divinité même, ne prennent réellement sens que par et dans l’ange, car le monde angélique est l’océan spirituel qui meut toute réalité et la transfigure. Il faut réintégrer l’ange dans notre conscience, le percevoir au fond de l’être, redécouvrir sa présence nécessaire, alors il reviendra dans la création spirituelle, philosophique, poétique, artistique.
Il est d’ailleurs possible que cette réintégration soit commencée. Qu’on nous permette d’en voir deux signes, dans des domaines très différents.
D’abord, l’œuvre immense du philosophe et orientaliste français Henry Corbin (1903-1978), à qui nous devons beaucoup. Centrée sur l’angélologie et l’expérience visionnaire de l’ange en islam, cette œuvre a exhumé d’un coup toute une partie du patrimoine spirituel de l’humanité, enrichi considérablement l’étude comparée des religions et le débat philosophique, nourri un questionnement sur l’angélologie chrétienne.
Les données du Nouveau Testament
A la lecture du Nouveau Testament, on est frappé, il est vrai, par le peu d’anges. La figure du Messie, du Fils de l’homme, relègue à l’arrière-plan, rend inutile ou périmée toute autre manifestation divine. Pourtant, les êtres célestes marquent de leur présence le début et la fin de la vie terrestre du Christ. Un ange annonce, en songe, à Joseph, la naissance de Jésus (Mt 1,20-33), accomplissement des prophéties messianiques. Un autre lui ordonne de fuir en Égypte, puis de rentrer avec les siens en Palestine à la mort du roi Hérode, le persécuteur (Mt 2,13-23). Luc commence aussi son récit par deux apparitions, tout à fait parallèles : celle d’un ange annonçant à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste (Lc 1,11-20) et celle de l’archange Gabriel, annonçant à la Vierge Marie la naissance du Sauveur (Lc 1,26-38). La manifestation aux bergers clôt avec ampleur et merveilleux la séquence de la Nativité, car le messager est rejoint par une armée céleste (Lc 2,8-14).
La seconde naissance du Christ, son entrée dans la vie publique par le baptême reçu des mains de Jean-Baptiste, est suivie d’une retraite de quarante jours au désert, durant laquelle Jésus doit subir les assauts de Satan. Là encore, des anges viennent servir le Sauveur, après qu’il a triomphé des tentations (Mt 4,11; Mc 1,13; Lc 4,9-13).
Parvenus au terme du ministère christique, nous retrouvons les anges au jour de Pâques, près du sépulcre vide. Aux saintes femmes qui se rendaient au tombeau ils délivrent leur message : « Il est ressuscité. » Cette manifestation est empreinte de merveilleux (Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-8). Elle est beaucoup plus sobre chez Jean, assez réticent dans l’ensemble à l’égard des anges (Jn 20,11-13). Ainsi, le cercle se referme : à l’annonce de la naissance terrestre répond l’annonce de la renaissance à une vie spirituelle. Les anges sont les signes parfaits de la proximité du Royaume de Dieu.
Particulièrement concentrée aux deux extrémités des évangiles, la présence angélique est plus dispersée dans les Actes des Apôtres : elle accompagne les premiers pas de l’Église. Au moment de l’ascension de Jésus, deux anges se présentent aux disciples et les rappellent à leur mission (Ac 1,10-11). Arrêtés et jetés en prison, les Apôtres sont délivrés par un ange du Seigneur qui leur ouvre les portes (Ac 5,19). Un peu plus tard, la même aventure advient à Pierre, prisonnier du roi Hérode Agrippa (Ac 12,6-11). Ce dernier meurt frappé par un ange, pour avoir omis de rendre gloire à Dieu (Ac 12,21-23). Cependant la figure la plus fréquente reste celle du messager céleste : un ange ordonne à Philippe de gagner la route de Gaza (Ac 8, 26), demande au centurion Corneille d’aller chercher Pierre à Joppé (Ac 10,333), avertit saint Paul que son navire va sombrer mais que l’équipage échappera à la mort (Ac 27,2225). L’apparition de l’ange semble souvent traduire une inspiration de l’Esprit. Mais les anges apparaissent aussi comme les figures d’un discours qui reflète la diversité des héritages, des influences et des controverses à l’époque du Christ.
La représentation des cieux change peu: ils sont toujours peuplés d’anges, dont les chœurs entourent le trône divin, acclament le Seigneur (Ap 5,11-14), accomplissent une liturgie éternelle (Ap 19,1-10). Leur hiérarchie reste dominée par «les sept anges qui se tiennent devant Dieu » (Ap 8,1-13); ce sont les anges aux sept trompettes.
Cependant, en employant les images issues des croyances communes, et en les mettant en scène d’une manière dramatique, l’Apocalypse de Jean accentue le sens eschatologique de la figure angélique : le Fils de l’homme paraît avec les anges, au jour du Jugement, et ceux-ci séparent les mauvais des justes ; ce sont les moissonneurs et les vendangeurs des nations (Ap 14,6-20). Ainsi se trouvent précisées les affirmations du Christ dans les évangiles (Mt 16,27; Mc 8,38; Lc 9, 26), où d’ailleurs il suggère déjà son rôle de président d’un tribunal angélique (Lc 12,8-9). Mais la dimension eschatologique culmine dans l’épisode fameux du «combat dans le ciel » entre Michaël et le dragon (Ap 12,7-9), doublé de la lutte entre le Verbe de Dieu et la Bête (Ap 19,11-21 et 20,1-3).

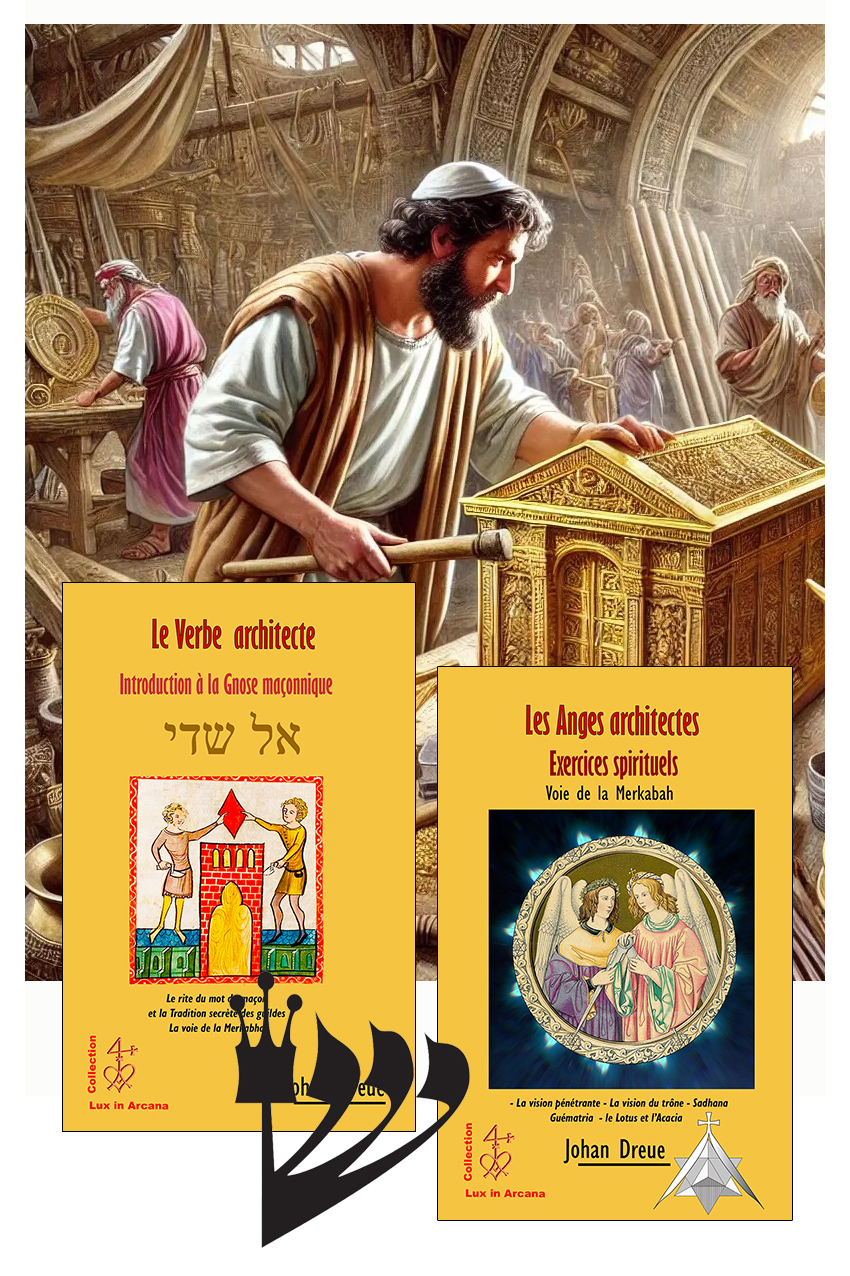












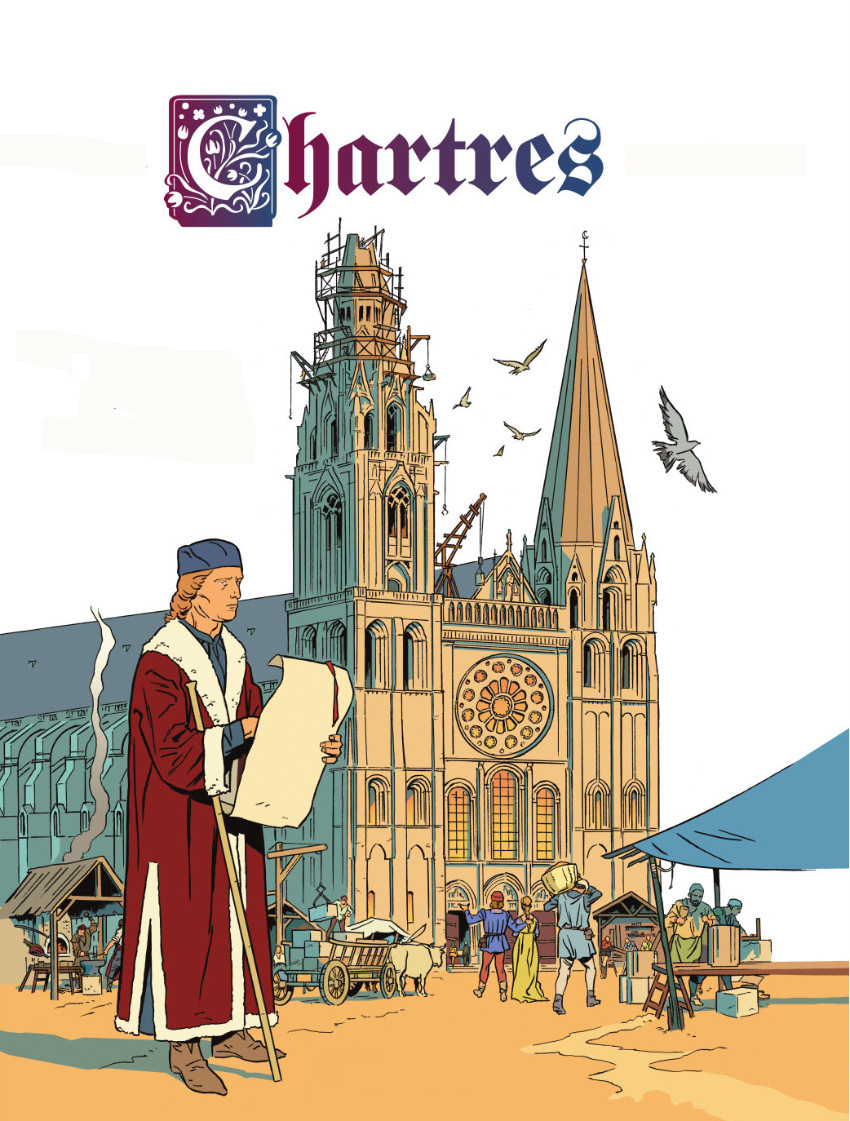

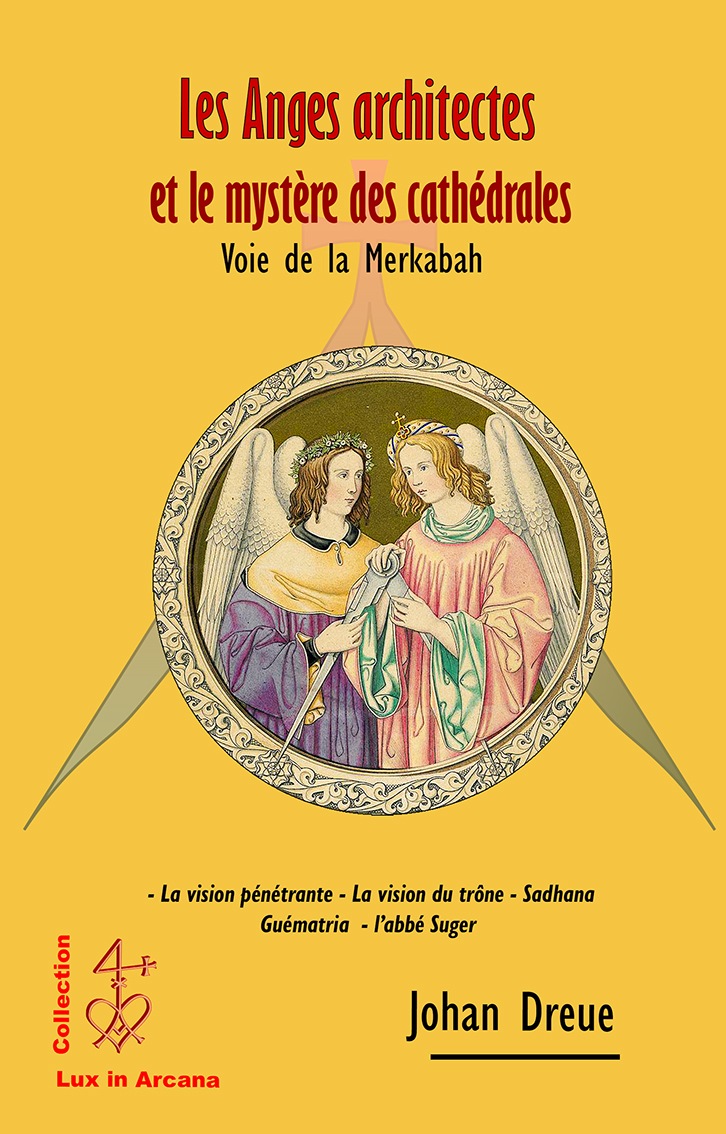

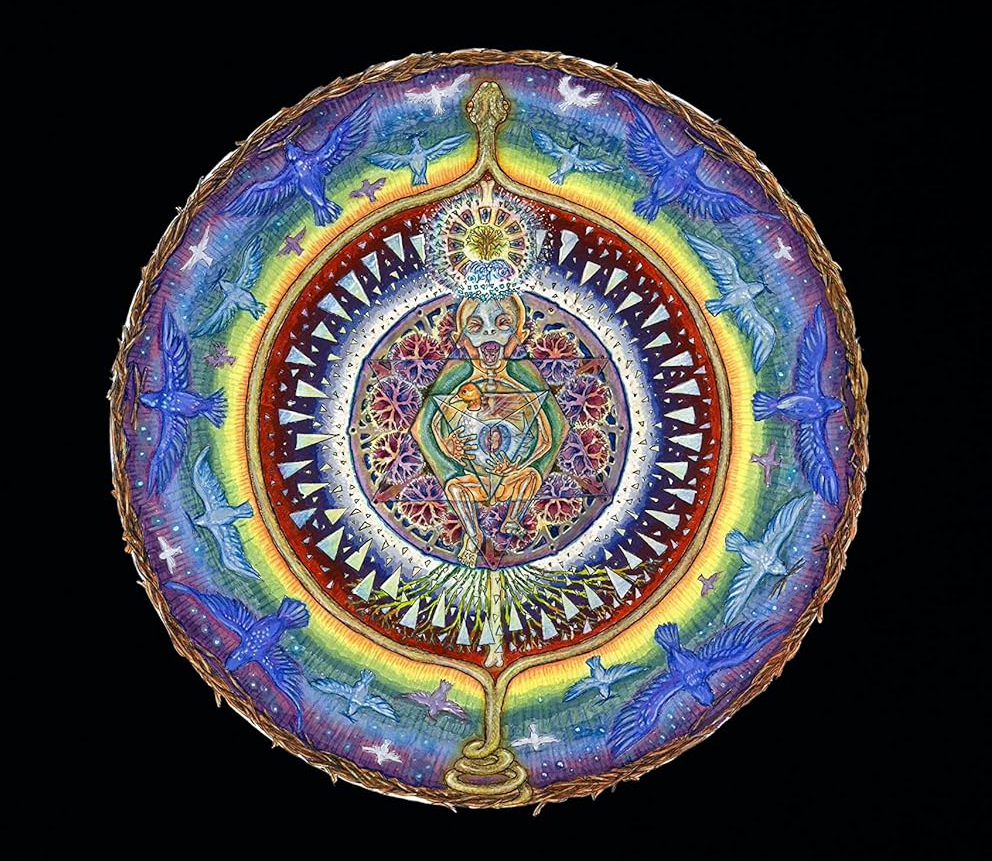





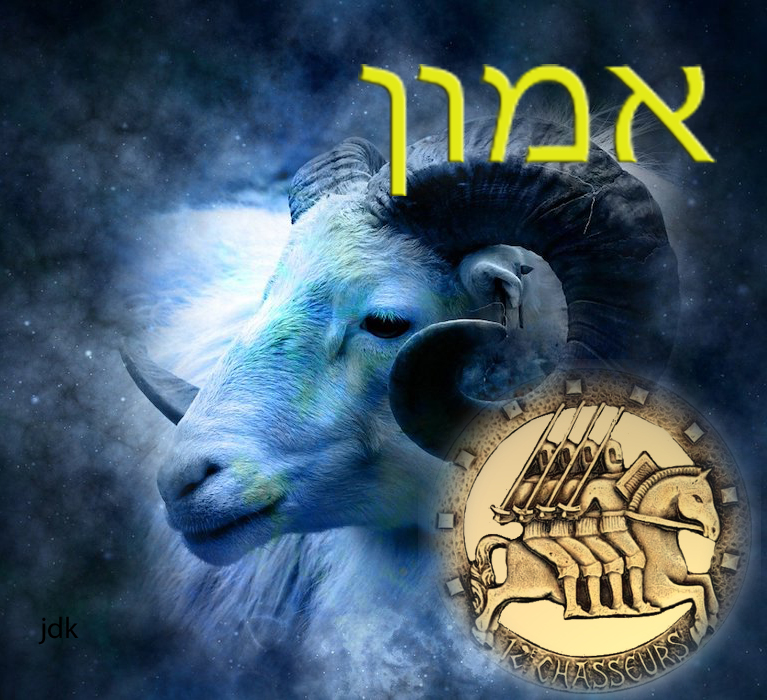

 Au bord du lac de Tibériade, les futurs disciples Jacques et Jean réparent leurs filets. Un homme passe. Une voix. Un regard… Jacques et Jean se lèvent et le suivent. Zébédée, leur père, reste dans la barque, médusé. Leur mère attend; elle a préparé un ragoût de poisson pour ses hommes fatigués par une nuit de pêche. Mais où donc sont ses fils? Ils ont suivi Jésus…
Au bord du lac de Tibériade, les futurs disciples Jacques et Jean réparent leurs filets. Un homme passe. Une voix. Un regard… Jacques et Jean se lèvent et le suivent. Zébédée, leur père, reste dans la barque, médusé. Leur mère attend; elle a préparé un ragoût de poisson pour ses hommes fatigués par une nuit de pêche. Mais où donc sont ses fils? Ils ont suivi Jésus…



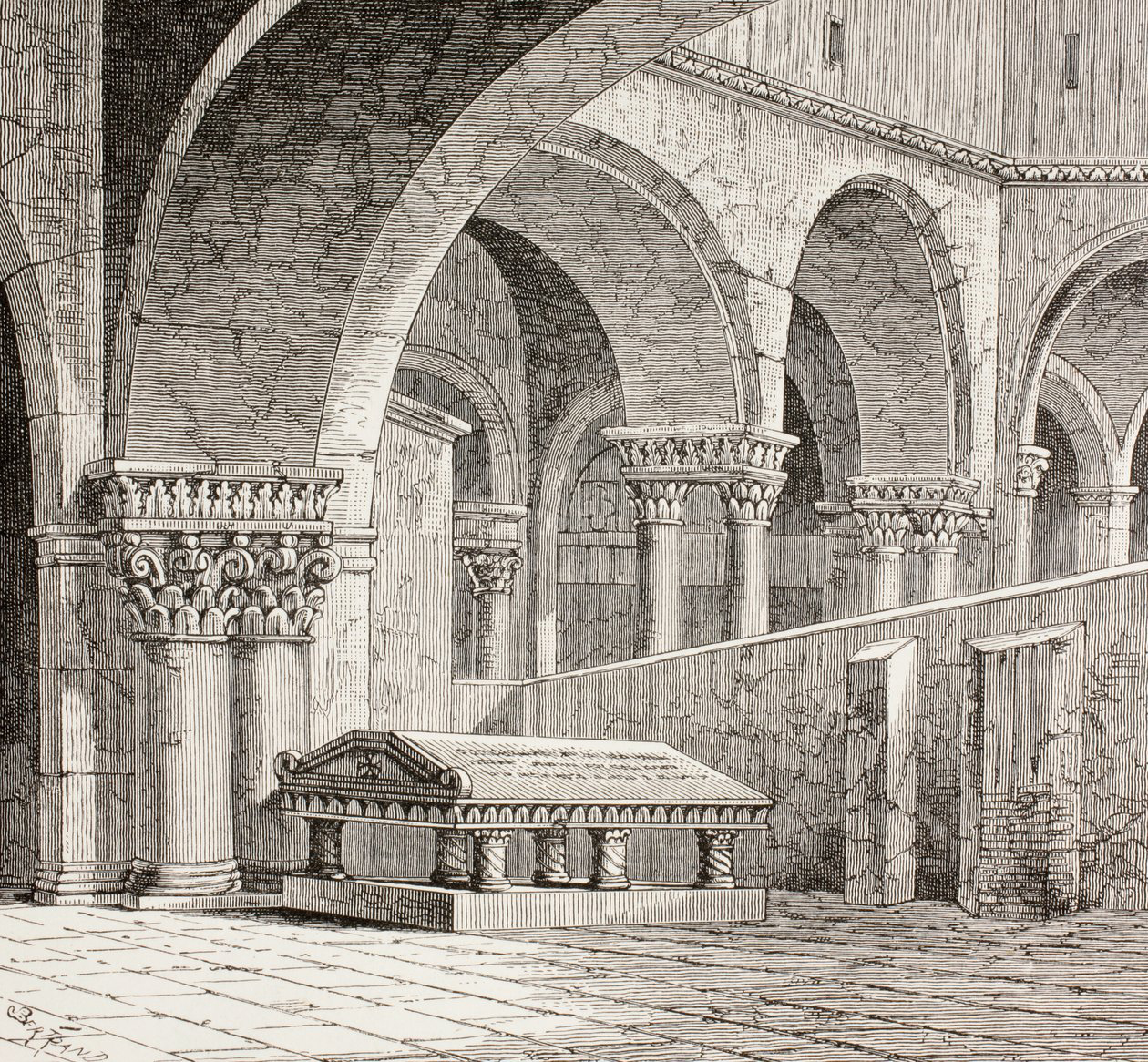
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.